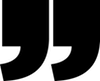Elisa Carrillo Cabrera est danseuse étoile au sein du Ballet de l’Opéra de Berlin. Dès le matin, l’artiste mexicaine s’échauffe, s’entraîne, répète les mêmes gestes encore et encore.
Quand le rideau s’ouvre le soir, douleurs et fatigue n’existent plus.
Jusqu’au lendemain matin.
Un court métrage documentaire réalisé par Veronika Pokoptceva
Photographie : Jan Boroewitsch, Athena Carmazzi
Montage : Veronika Pokoptceva, Tom Gregory Janson
Son : Rafael Prado, Effy Cerutti, Benjamin Zappi-Giannotti
Musique : Rafael Prado, Alexey Kochetkov
Interview

Veronika Pokoptceva Réalisatrice
“La caméra ne fait pas qu’observer, elle participe. Elle suit les mouvements d’Elisa, sa respiration, ses pensées. Elle danse avec elle.”
- Peux-tu te présenter, Veronika ?
Je suis réalisatrice, scénariste et productrice, basée à Berlin. Je suis née à Saint-Pétersbourg, en Russie, où j’ai été diplômée de l’Université d’État du cinéma et de la télévision, en réalisation. J’ai commencé ma carrière dans de petites sociétés de production, spécialisées dans les contenus pour la télévision, où j’ai occupé divers postes : journaliste, réalisatrice, monteuse.
Il y a environ sept ans, j’ai déménagé en Allemagne. C’est là que j’ai décidé de me consacrer pleinement au cinéma.

Comment as-tu rencontré Elisa, et comment est né ce film ?
J’ai rencontré Elisa par l’intermédiaire de son mari, Mikhail Kaniskin, qui danse avec elle dans le film.
Au départ, il m’avait contactée parce qu’il cherchait, de manière assez inattendue, une… graphiste. Je ne me considère pas comme une graphiste professionnelle, mais cela m’arrive de faire quelques créations. Et ce qui devait être une petite collaboration s’est transformé en une relation de travail, et une belle amitié.
Le film sur Elisa était en fait mon projet de fin d’études à l’Institut SAE de Berlin, une école de cinéma privée. Nous avions une liberté de création totale. Le film pouvait être une fiction, un documentaire, une publicité, un clip… C’est à ce moment-là que m’est venue l’idée de réaliser un portrait documentaire sur Elisa. J’ai toujours eu un amour profond pour le documentaire, et j’avais déjà travaillé sur plusieurs projets dans ce domaine, surtout pour la télévision.
C’était aussi l’occasion de collaborer avec l’une des étoiles du ballet berlinois, ce qui rendait le projet encore plus enthousiasmant. Elisa et Mikhail avaient déjà participé à beaucoup de projets télé et cinéma, surtout au Mexique, mais aussi en Allemagne. Mais je crois que mon film étudiant, réalisé sans budget, leur a permis de vraiment montrer qui ils sont.
“Beaucoup de gens ont été surpris d’apprendre qu’Elisa et Mikhail sont mariés parce qu’à l’écran, ça ne saute pas du tout aux yeux !”
- Comment Elisa et Mikhail travaillent-ils ensemble ?
Mikhail et Elisa sont ensemble depuis plus de vingt ans. Il y a entre eux un amour fort, profond. Mikhail a été danseur étoile au Ballet de l’Opéra de Berlin pendant plus de quinze ans, et aujourd’hui, il se consacre davantage à l’enseignement. Ils continuent toutefois de se produire ensemble, et honnêtement, c’est incroyable à voir. Je crois que la passion qu’ils ont l’un pour l’autre, cet amour un peu fou, absolu, donne une intensité unique à leurs prestations en duo.
- Et pourtant, dans le film, on ne dirait pas qu’ils sont en couple. Il y a une forme de distance, de froideur…
Quand ils entrent en salle de répétition, tout tourne autour du travail. Elisa devient la ballerine, Mikhail devient le maître de ballet. Beaucoup de gens ont été surpris d’apprendre qu’ils sont mariés parce qu’à l’écran, ça ne saute pas du tout aux yeux !
Mais je vais vous confier un petit secret : nous avons coupé quelques instants du film, littéralement quelques images, parce qu’Elisa et Mikhail trouvaient qu’elles n’étaient « pas assez professionnelles ». D’un point de vue personnel, rien d’inhabituel. Mais en tant que danseuse et maître de ballet, ils craignaient que ce soit trop intime. Pour être honnête, un spectateur lambda n’aurait probablement rien remarqué. Mais le monde du ballet est strict. Et souvent impitoyable.

- Tu sembles bien le connaître, ce monde du ballet.
J’ai effectivement un passé de danseuse, et je pense que c’est une des raisons pour lesquelles je me sens si proche de ce genre d’histoires. Vers l’âge de huit ans, j’ai commencé les compétitions de danse de salon, et j’ai continué pendant environ sept ans. Ce n’était pas juste un loisir, c’était une énorme part de ma vie. Ma mère garde encore tous les diplômes, médailles et trophées que j’ai remportés dans divers tournois !
Finalement, j’ai choisi une autre voie, et je n’ai jamais regretté ce choix. Mais la danse reste ma passion secrète. Elle m’inspire. Parfois, quand je suis un peu à plat, je danse. Ça m’aide à me reconnecter à moi-même.
“Elisa a tout enduré : un travail acharné, des années loin de sa famille, l’intégration dans un nouveau pays et, bien sûr, les discriminations.”
- Pourquoi avoir choisi le thème du ballet, un univers difficile à filmer, souvent très fermé ?
En fait, je ne l’ai pas vu comme un milieu fermé. Nous n’avons pas eu de problème pour obtenir des autorisations de tournage ou pour accéder aux coulisses, car mon équipe et moi étions sous l’aile d’Elisa et de Mikhail. Ils nous ont soutenus avec énormément de générosité, et nous ont aidés dans de nombreux aspects logistiques. Grâce à eux, on est un peu entrés dans ce monde « de l’intérieur ».
Et puis, avec mon parcours en danse, le ballet ne m’a jamais semblé lointain ou intimidant. Enfant, je rêvais moi-même de devenir ballerine. Et puis j’ai grandi en Russie, où le ballet fait pratiquement partie de l’identité nationale. Mes parents m’emmenaient régulièrement au théâtre, voir des ballets. À chaque fois, j’en sortais bouleversée.

- Le ballet est souvent perçu comme un art européen, occidental, “blanc”. Quel a été le parcours d’Elisa, qui est née au Mexique ?
Ce qui m’a attiré chez Elisa, ce qui m’a vraiment poussé à faire ce film, c’est son histoire. Comment une jeune fille issue d’une famille modeste au Mexique est-elle devenue une étoile du ballet allemand ?
Elisa aime parler de son enfance. Elle se souvient parfaitement du moment où elle a vu un ballet pour la première fois, de ces ballerines qui flottaient sur scène dans leurs magnifiques tutus. Elle s’est alors dit qu’elle aussi, elle monterait un jour sur scène, vêtue d’un magnifique tutu. Sa famille l’a toujours soutenue, dès le début.
Se lancer dans une carrière de ballerine n’est jamais facile, mais le talent d’Elisa s’est vite imposé. À 16 ans, elle a été invitée à rejoindre l’École nationale de ballet en Angleterre. Plus tard, elle est partie à Stuttgart, où elle a intégré la compagnie de ballet. Comme presque tous les danseurs, elle a commencé dans le corps de ballet. Et l’année dernière, elle a terminé sa carrière en tant qu’étoile du Ballet de l’Opéra de Berlin, une compagnie qu’elle avait rejointe en 2011.
Elisa a tout enduré : un travail acharné, des années loin de sa famille, l’intégration dans un nouveau pays, et bien sûr, les discriminations liées à sa couleur de peau et à ses origines. Mais d’une certaine façon, tout cela l’a rendue plus forte et plus déterminée.
- Pourtant, ton film ne dit rien du parcours d’Elisa. Tu choisis au contraire de te concentrer sur l’échauffement, l’entraînement, la répétition des gestes, sur ce qui se joue loin du regard du public. Pourquoi ce choix ?
Au début, j’avais envisagé que le film raconte son parcours et les épreuves qu’elle avait traversées pour accomplir son rêve. Mais un jour, on s’est retrouvés tous les trois autour d’un café avec Elisa et Mikhail, et on a parlé pendant des heures. De tout : la vie, l’enfance, le travail… Après cette conversation, j’ai réalisé que même avec mon expérience en danse, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passe en coulisses dans les grandes compagnies de ballet. Et c’est à ce moment-là que le vrai concept du film a émergé.
Les gestes simples, presque banals, qui constituent la routine quotidienne d’une danseuse étoile, m’ont soudain paru incroyables. D’une certaine manière, cette routine était pour moi encore plus fascinante que le parcours d’Elisa et ses combats passés. Ce qui m’a profondément marqué, ce sont les émotions et réflexions partagées par Elisa et Mikhail, leur compréhension du métier, la finesse du geste, la manière dont ils habitent chaque rôle avec une telle intensité émotionnelle. C’est cela que j’ai voulu capturer à l’écran.

- La caméra est très proche du personnage, alternant plans fixes et caméra portée à l’épaule. Quelle était ton intention, sur le plan narratif et technique ?
J’adore les gros plans et les plans très détaillés. C’est comme si la caméra regardait le personnage droit dans les yeux, dans l’âme. Cela devient une expérience très intime. C’était mon intention première.
La quasi-totalité du film est mise en scène. Ce que l’on voit, c’est le travail quotidien d’Elisa, ses répétitions, son entraînement, tout est réel. Mais d’ordinaire, une telle répétition se déroule en groupe. On n’aurait pas pu filmer d’aussi près avec des dizaines de danseuses et danseurs dans la même pièce. On serait resté dans l’observation, or ce n’était pas le sentiment que je voulais transmettre. Ici, la caméra ne fait pas qu’observer, elle participe. Elle suit les mouvements d’Elisa, sa respiration, ses pensées. Elle danse avec elle. Elisa est vivante, et la caméra devient vivante avec elle.
Les plans fixes, eux, créent un contraste. Ils ouvrent un espace, une pause, un moment de calme. Une respiration pour Elisa, et pour le spectateur. Au début et à la fin du film, on la voit entrer dans une salle de répétition vide. Comme si tout l’espace l’attendait, prêt à se remplir de son énergie. Le montage suit cette intention : respirer avec elle.
- Le court documentaire documentaire Le Prodige, réalisé par Mike Sugrue et disponible sur 99, suit l’étoile du Bolchoï Olga Smirnova [qui a quitté la Russie pour rejoindre le Ballet national des Pays-Bas]. On y découvre une jeune femme solitaire, presque isolée. Est-ce aussi le cas d’Elisa ? Est-ce un trait commun aux danseurs, qui sacrifient tant à leur art ?
C’est vrai que le monde du ballet est dur, parfois impitoyable. La compétition est intense, les ragots, les intrigues en coulisses, les rivalités… Il faut trouver sa manière de survivre dans tout ça.
Il ne faut pas oublier qu’un parcours dans le ballet exige des années d’entraînement intense, jusqu’à l’épuisement. Et cela, quel que soit le niveau. Comme le montre le film, les danseuses et danseurs étoiles s’entraînent encore plus dur que les autres membres du corps de ballet. Parce que même si vous êtes au sommet, quelqu’un de plus jeune, de plus talentueux, risque toujours de prendre votre place… Le talent et les capacités physiques sont essentiels, mais sans discipline et sans travail acharné, il est presque impossible de réussir. Cet effort constant façonne aussi le mode de vie. Quand on passe ses journées à s’entraîner, il reste peu de place pour la vie sociale.
Mais je ne dirais pas qu’Elisa est coupée du monde ou uniquement centrée sur son travail. Pour elle comme pour Mikhail, le ballet est central, oui, mais ils mènent aussi une vie culturelle et sociale très riche. Ils organisent des festivals, des masterclasses, se produisent partout dans le monde, travaillent avec des enfants et de jeunes danseurs. Ils ont aussi une fille merveilleuse, à qui ils consacrent beaucoup de temps.
Peut-être qu’au début de leur carrière, ils ont pu se retrouver isolés. Mais je pense que le fait qu’ils se soient trouvés, qu’ils aient construit un couple aussi fort et aimant, cela les a beaucoup aidés à rester ancrés et connectés émotionnellement, même dans cet univers exigeant.
- Quel regard portes-tu sur le format du court métrage documentaire ?
Je ne crois pas qu’il faille faire une distinction trop rigide entre court et long métrage documentaire. Bien sûr, il y a des différences, c’est évident. Mais pour moi, tout dépend de l’histoire. Certaines sont courtes, d’autres longues, et c’est notre rôle de choisir le format le plus adapté à chacune.
Il y a quelques années, je discutais avec un journaliste cinéma. Il me disait combien il trouvait triste que le secteur considère encore les courts métrages comme une simple étape de transition, un format qui réservé aux étudiant·es, une sorte de répétition avant de faire un « vrai film ». Et malheureusement, il a raison. Les diffuseurs ne s’intéressent quasiment pas aux courts. Ils veulent des longs et des séries.
En dehors du circuit des festivals, il y a très peu de débouchés pour les courts. Récemment, j’ai voulu proposer un projet documentaire court à un forum de pitch en Allemagne, un festival pourtant très réputé. Mais ils m’ont répondu qu’ils ne prenaient quasiment jamais de courts, car les diffuseurs n’en veulent pas !
Heureusement, il existe aujourd’hui des plateformes en ligne comme 99, où les courts peuvent vivre et trouver leur public. C’est génial, car cela les rend visibles au-delà des festivals. Et d’un certain point de vue, le fait que l’industrie considère encore les courts comme “pas assez sérieux” laisse plus de liberté aux auteur·ices. Cela permet au court métrage documentaire de rester plus artistique, plus indépendant, plus expérimental, plus personnel.